DPE : Les diagnostiqueurs fraudeurs dans la ligne de mire
SOMMAIRE
Un arrêté publié le 28 juillet 2025 instaure un seuil inédit : au-delà de 1 000 diagnostics de performance énergétique réalisés par an sur des logements individuels, les diagnostiqueurs s’exposent à une suspension. La ministre en charge du Logement souhaite mettre fin aux évaluations bâclées ou fictives. L’ADEME, chargée de détecter les volumes anormaux, enclenchera ce contrôle renforcé dès le 1ᵉʳ octobre 2025.
Couper court aux DPE “à la chaîne”
Derrière le jargon réglementaire, l’arrêté du 28 juillet 2025 introduit une arme simple : un seuil annuel de 1 000 diagnostics de performance énergétique (DPE), calculé sur douze mois glissants et limité aux logements individuels (maisons et appartements). Les DPE collectifs, comme ceux réalisés pour un immeuble entier, ou ceux générés automatiquement à partir d’un diagnostic de bâtiment, échappent au dispositif .
Le texte définit ainsi ce qu’il nomme « exercice manifestement irréalisable » : un rythme de travail tel qu’il laisse supposer que les inspections ont été écourtées, voire fictives. Avec une entrée en vigueur prévue le 1ᵉʳ octobre 2025, cette mesure rejoint le calendrier plus large de fiabilisation du DPE, amorcé par l'arrêté du 16 juin 2025 sur la certification et les méthodes de détection des anomalies.
Un coup de vis qui ne tombe pas du ciel
Si ce plafond des mille DPE annuels voit le jour en 2025, c’est qu’il s’appuie sur un faisceau de signaux d’alerte. Dans un rapport publié le 3 juin 2025, la Cour des comptes pointait l’inefficacité des contrôles : sur les quelque 4,6 millions de DPE réalisés en 2023, seuls 0,08 % ont été vérifiés. Le rapport dénonçait un dispositif « trop parcellaire » et préconisait l’utilisation d’outils statistiques, l’instauration d’une carte professionnelle et une meilleure information des usagers.
Une exigence de fiabilité qui tombe dans un contexte réglementaire déjà sous tension. Depuis le 1er juillet 2021, le DPE est opposable : une erreur manifeste peut conduire à la responsabilité du diagnostiqueur. Le calendrier de lutte contre les passoires thermiques, lui, s’accélère : les logements classés G sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025, les F suivront en 2028, et les E en 2034. Chaque diagnostic erroné peut donc fausser une vente ou bloquer une mise en location.
S’y ajoutent les critiques venues du terrain et relayées dans la presse nationale, dénonçant les « DPE-minute » réalisés en quelques dizaines de minutes, sans mesure précise ni vérification des installations. Face à cette défiance, le ministère veut montrer qu’il ne se contente plus de recommandations, mais impose désormais un garde-fou chiffré et contrôlable.
Dans les rouages du radar anti-DPE fictifs
Le cœur du dispositif repose sur un maillage technologique déjà en place mais jusqu’ici discret : l’Observatoire DPE-AUDIT de l’ADEME. Chaque diagnostic, une fois validé par le diagnostiqueur, est transmis à cette base nationale. Dès l’automne 2025, un algorithme y scrutera deux signaux principaux : le volume total de DPE déclarés et les incohérences statistiques entre les données relevées sur le terrain (surface, équipements, isolation) et les résultats calculés.
Ce seuil des 1 000 DPE par an est un déclencheur automatique : franchi sur douze mois glissants, il alerte l’ADEME. Le système écarte toutefois les cas spécifiques (diagnostics collectifs ou générés à partir d’un autre rapport) afin de ne pas sanctionner les missions d’envergure légitimes.
Une fois l’alerte émise, le relais est pris par l’organisme certificateur du professionnel. Celui-ci notifie le diagnostiqueur, ouvre un droit au contradictoire et exige des justificatifs :
- contrats signés,
- rapports détaillés,
- preuves de présence sur site...
Si la réponse ne convainc pas, la suspension de l’activité DPE est prononcée, pour une durée définie dans la procédure de certification.
L’arrêté du mois de juin avait déjà préparé le terrain en renforçant les exigences de traçabilité et de contrôle des diagnostics émis. Le texte du 28 juillet vient, lui, y adjoindre une protection statistique destinée à faire tomber les opérateurs qui “signent” plus qu’ils ne visitent.

Ondes de choc chez les pros et les propriétaires
Est-ce pour autant un couperet pour les diagnostiqueurs ? Pas pour tous. Ceux qui, jusqu’ici, accumulaient les missions à cadence industrielle devront réorganiser leurs tournées, allonger le temps passé sur site et documenter davantage leurs visites. Les organismes certificateurs, déjà habilités à suspendre une certification en cas de manquements graves, disposeront désormais d’un outil objectif pour enclencher cette procédure. Une suspension est une privation d’exercer en plus de la perte de contrats en cours et d'un coup massif porté à la réputation professionnelle.
Côté vendeurs et bailleurs, la mesure est là pour sécuriser un document devenu stratégique. Un DPE erroné peut modifier la valeur d’un bien, compliquer une vente ou interdire une mise en location, notamment depuis le 1er janvier 2025 et la sortie des logements classés G du marché de la location. Les prochaines étapes pour rayer les classes F et E du parc locatif dans les années qui viennent renforcent encore plus la pression pour obtenir des diagnostics irréprochables.
Les agences immobilières et syndics, eux, devront être plus vigilants sur les documents transmis par leurs prestataires. Mais des outils seront mis en place pour leur faciliter la tâche, permettant de vérifier l'enregistrement et la validité du diagnostic.
Détecter un DPE frauduleux : Quels outils ?
Vérifier un diagnostic ne relève pas d’un travail d’expert, à condition de connaître les bons points de contrôle. Il faut d'abord repérer le numéro de certification du diagnostiqueur, mentionné sur le rapport, ou flasher son QR Code de certification (en vigueur depuis le 1er juillet 2025). Celui-ci doit correspondre à un professionnel en activité et certifié par un organisme agréé. Une recherche rapide sur le site de l’Observatoire DPE-AUDIT permet de s’en assurer.
Au 1er septembre 2025, un deuxième QR code officiel sera mis en place, et figurera sur chaque DPE. Il donnera accès, via smartphone ou ordinateur, à la version enregistrée dans la base nationale, garantissant que le document n’a pas été modifié. En attendant, il reste possible de comparer les informations techniques relevées (année de construction, surface, type de chauffage, isolation) avec la réalité du logement. Des écarts majeurs (par exemple une chaudière absente ou un vitrage double annoncé alors qu’il est simple...) doivent alerter.
En cas de doute sérieux, la première démarche consiste à solliciter l’organisme certificateur du diagnostiqueur, qui pourra diligenter une contre-visite. Si la suspicion de fraude persiste, la DGCCRF peut être saisie pour pratiques commerciales trompeuses. Dans le cadre d’une transaction, le notaire peut aussi jouer un rôle de médiateur, notamment si l’erreur est détectée avant signature.
Ces vérifications préventives prennent peu de temps mais peuvent éviter des conséquences lourdes comme une vente annulée, un loyer interdit ou des travaux imprévus.
Les conclusions et recommandations de la Cour des Comptes
Au regard de ce qui précède, toutes les leçons de la mise en œuvre du DPE doivent être tirées en vue des prochaines échéances de 2028 et 2034, s’agissant aussi bien du pilotage global du dispositif, que de sa mise en cohérence avec d’autres réglementations et de sa bonne appropriation par le public.
Le modèle de régulation de la filière, qui repose principalement sur des organismes tiers chargés de certifier les diagnostiqueurs et sur le contrôle de la DGCCRF dans un champ de compétences limité, doit intégrer un véritable contrôle de la probité et une prévention des conflits d’intérêts notamment au regard des liens structurels existants entre certains organismes de certification et de formation.
La Cour appelle à une régulation et à un contrôle accru de la part de l’État afin de prévenir les risques de fraude et d’irrégularités. Le plan d’action adopté à ce sujet par le gouvernement le 19 mars 2025 témoigne de l’importance attachée à cet objectif, en écho aux constats et recommandations du présent rapport de la Cour.
La Cour formule les recommandations suivantes :
- Poursuivre la structuration de la filière avant fin 2026, notamment en instaurant une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs afin de prévenir la fraude et garantir la confiance du public (ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) ;
- Instaurer une incompatibilité géographique pour les auditeurs par rapport à leurs fonctions antérieures avant fin 2026 (ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche) ;
- Garantir une stricte séparation de l’exercice des missions de formation initiale et de certification avant fin 2026 (ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche).
Rapport public sur la mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique, Cour des Comptes
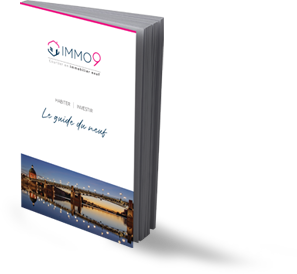

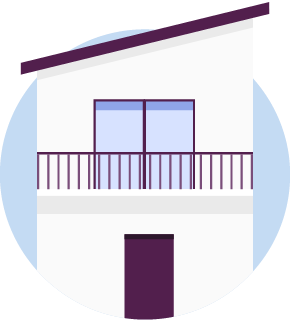
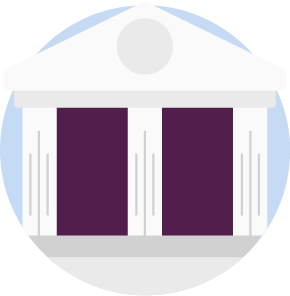





 Hervé Koffel
Hervé Koffel












Commentaires à propos de cet article :
Ajouter un commentaire